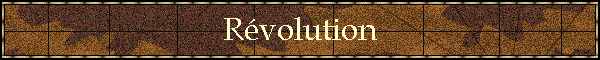
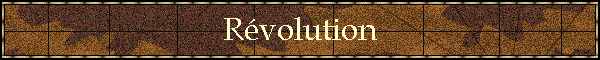
Jean Isaac de Boysson, né en 1695, dont les titres sont "Seigneur de Bouygues, de Lagrange, de Gindou" a tenu durant son existence un livre de raison sur lequel ont été notifiés ses comptes et évènements de la vie quotidienne. Ainsi, ses notes témoignent de la vie et la météo de Gindou sur plus d'un demi siècle.
C'est en 1736 que Marie-Anne Lavergne devient son épouse dans l'église de Saint-Martin. Elle lui apporte alors le domaine des Granges, connu aujourd'hui sous le nom de la "Boissonnie", et le Mas de Peyre.
Jean Isaac effectue le trajet Rampoux-Gindou quotidiennement et couche alternativement dans chacun de ces villages, excepté durant les gros travaux agricoles, les vendanges. Il demeure alors plusieurs jours dans la même propriété.
C'est aussi le cas si les conditions climatiques l'exigent. Notamment en Janvier 1747 , les fortes pluies font déborder tous les ruisseaux, l'empêchant de traverser l'Ourajoux pour se rendre d'un village à l'autre. Dans cette vallée, un des moulins lui appartient.
Il développe la vigne à Gindou, à la Boissonnie mais aussi à Marguerit. Les récoltes sont variables d'une année à l'autre avec neuf barriques en 1746, sept barriquots en 1749 et quatorze petites barriques en 1760.
Personne sociable, le noble paie le cordonnier pour son valet, le médecin pour son meunier, aide ses anciens serviteurs, semble très touché pour le décès de son fidèle valet. Ses enfants reçoivent un violon en cadeau et partent plusieurs fois en voyage à Toulouse. En 1769, la nourrice d'un enfant abandonné est soutenue.
Ses principales sorties d'argent sont les dépenses relatives aux enfants, le sel, les chaussures, le tabac, la perte de boeufs. Les crédits viennent de la vente de boeufs, de blé, de porc, de mouton, quelquefois de vin, les commissions sur les ventes de ses métayers. Les foires de Catus, de Cazals ou de Salviac sont l'occasion d'échanges commerciaux. Le troc est aussi pratiqué, en 1761 son métayer du mas de Boysson (actuel mas de Peyre) échange une paire de taureaux contre une paire de boeuf.
Divers évènements remarquables sont relatés dans son carnet. En Juillet 1762 le chevalier de Vielcastel a été capturé par douze cavaliers de la maréchaussée et conduit en prison où il meurt trois jours plus tard. S'agit-il de Vielcastel de Cazals qui, à la même époque, a assassiné son frère
Jean-Louis, et dont Jean Isaac de Boysson racheta les créances?En 1763, une girouette en croix est achetée pour l'Eglise de Gindou. La même année, sa fille cadette à laquelle il était très attaché succombe à sa maladie.
Jean Isaac de Boysson décède à l'âge de 86 ans et repose à Rampoux. Il était Juge Royal à Cazals.
Son fils, Bernard, personne également érudite, connaîtra une existence beaucoup plus mouvementée du fait de son ambition, des évènements liés à l'époque qu'il traverse et des drames familiaux.
Les possessions de Gindou lui sont laissées. En 1777, il finance la fonte de la cloche de Gindou. Son épouse Jacquette, marraine, donne 3 livres d'étrennes aux fondeurs.
L'année suivante, trois livres sont données pour l'envoie d'une fille abandonnée à l'hôpital de Gourdon.
"...elle semblait dans son lit de mort, un ange
endormi."
En 1782, sa compagne tombe gravement malade, l'aumône est distribuée pour intéresser la prière des pauvres à sa guérison. Jacquette de Cadolle s'éteint à l'age de 31 ans. Très affecté par son décès, Bernard de Boysson consacre six pages de son livre de raison à son éloge. Sa beauté, son caractère, sa bonté, la justesse de son jugement, sa modestie sont loués: "son âme se communiquait à qui l'environnait".
Comme son père, Bernard de Boysson s'intéresse à la culture, la philosophie, la géographie. Il achète une encyclopédie, des cartes géographiques, s'abonne à une revue littéraire.
"...il n'a passé comme une fleur qui n'a vu qu'une aurore." Ecrira-t-il de son fils aimé, mort à l'age de six ans.
Magistrat à la Cours des Aides de Montauban avant l' âge requis, l'Avocat tentera de racheter les droits des domaines royaux de Cazals et Dégagnac. Cela suscitera son discrédit au près de la population cazalaise à l'aube de la révolution. En décembre 1798, ses demeures à Gindou et Rampoux sont pillées.
En Janvier 1793, les autorités révolutionnaires demandent aux communes d'établir la liste des personnes ne pouvant justifier la présence de leurs enfants sous les drapeaux. Les municipalités des deux villages semblent peu enclines à dénoncer les de Boysson et se renvoient respectivement la responsabilité.
Bernard est néanmoins arrêté le 11/11/1793 , comme père d'émigrés, et sera libéré en 1795. Ses biens sont saisis. La sympathie et les faveurs des habitants de Rampoux lui permettent de se reconstruire.
Le retour de ses enfants, dont Amédée qui a épousé une allemande, se transformera vite en nouveau déboire. Un procès opposera le père et le fils en 1807. Bernard de Boysson décède en 1817.
![]()
Pendant la période révolutionnaire, Gindou est le théâtre d'affrontements violents. Le 7 Juin 1790, les autorités sont informées que des citoyens ne veulent pas payer la dîme. Les paysans dressent des mais, signes d'affranchissement.
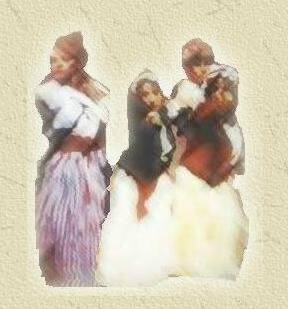 Les femmes de Gindou.
Les femmes de Gindou.Pendant la révolution, les prêtres doivent prêter serment. A Maussac et Gindou, les curés sont réfractaires. Ils ont le soutient des femmes. Elles bloquent la route à Gindou, pour empêcher les gendarmes d’amener le curé de Cazals en prison, à Cahors. Ces derniers, avertis, préfèrent les éviter et contournent Gindou par Les Arques.
Le curé réfractaire de Gindou continue à célébrer la messe clandestinement.
A Maussac, Jean-Louis Martin nommé en 1782, refuse le serment constitutionnel .Il est remplacé par Lagard vicaire de Salviac en 1791, puis par Guilhou, jacobin ,en 1794.
Après la révolution, les paysans vendent tous les 27 du mois, leur récolte à Cazals. Jour qui est resté jour de foire à Cazals jusque dans les années 1980. Ils y amènent blé, noix et vin. Malheureusement, cette période de prospérité se termine avec l'arrivée du Phylloxéra en 1876. C'est le début de l'exode et, pour certains, de l' émigration vers l'Argentine .
Le maître d'école rapporte à son supérieur un descriptif de la commune, sa population,ses activités, ses moeurs. Il vante déjà la qualité du vin de Gindou ainsi que de ses truffes.
"La nature du sol n’est pas uniforme : il y a du calcaire, du sabloneux et de l’argileux ; et l’ensemble du pays est très accidenté. Tantôt ce sont des plaines assez étendues, et ensuite des pentes rapides ; on y récolte toutes les espèces de céréales, la pomme de terre, la betterave ; les plantes textiles, les noix et le vin. Ce dernier produit est même recherché ; et à en juger par les expéditions faites de nos jours sur les divers points de l’Empire, font présager qu’à l’avenir, les vins rouges et blancs de Gindou seront d’un écoulement facile et surtout bien goûtés. On y trouve aussi beaucoup de truffes dont la belle qualité, la forme et le parfum les font estimer par tous les amateurs.
Quant aux plantes industrielles, il y en a pas dans la communes ; cependant on y voit du lin et du chanvre, mais en petite quantité.
Les arbres fruitiers sont l’abricotier, le figuier, le noisetier, le noyer, le pêcher, le poirier, le pommier, le prunier ; et surtout la vigne, comme je le dis au commencement.
Les animaux domestiques dont on fait usage dans la commune sont le cheval et le bœuf. Les animaux de basse cours sont le porc, la poule, l’oie, le canard, le dindon et surtout le pigeon. Pour les animaux vivant à l’état sauvage, il n’y en a pas.
La principale industrie est l’agriculture ; quand à la manufacturière et à la commerçante il n’y en a pas ; car on ne remarque dans la commune que trois ou quatre tisserands et deux ou trois forgerons. En général, les habitants de Gindou, quoique n’ayant pas une fortune colossale, jouissent d’une certaine aisance. Je dois dire en passant, qu’il y a sept à huit propriétaires qui possèdent en moyenne 100 mille francs chacun et une dizaine au dessus de 40 mille francs ; les autres sont plus ou moins riches, mais il n’y en a pas qui aillent mendier leur pain..]
[..Il y a dans la commune de Gindou deux églises et trois écoles de garçons ou de filles, mais aucun de ces établissements n’a rien de remarquable. Cependant, je dois dire que l’école des garçons est assez bien, ce que l’on peut remarquer sur le plan ci-joint, à savoir : le rez de chaussée comprend un corridor, la salle de classe, la salle de la mairie et un jardin de 100 mètres carrés. Au premier étage se trouve la cuisine, deux chambres et une autre petite chambre de décharge. La construction de cette école date d’une vingtaine d’année. Quant à celle des filles de Gindou et de Moussac (cette dernière est mixte), elles ne datent pas de plus de dix ans. L’instruction chez les jeunes gens n’est guère élevée, et la cause de ce manque d’instruction sont les grandes occupations en ce qui concerne l’agriculture, car il y a eu cependant des instituteurs depuis plus de 80 ans. Le premier instituteur qu’il y a eu n’apprenait qu’à lire, écrire et compter. Enfin, ces bons maitres se sont succédés dans l’ordre suivant depuis cinquante ans, savoir : Chabert, Demeaux, Gizard, Soulié, Vaquié et Palisse Joseph. Je peux dire que l’instruction a fait des progrès malgré les travaux des champs, car les hommes d’un age mur sont presque tous illettrés tandis que la jeunesse d’aujourd’hui savent (sic) tous ou à peu près signer.
Les noms des institutrices de Moussac sont : Counord Françoise, Laborie Françoise, Canihac Léontine, Lacoste Marie, Lagarrigue Antoinette et Roujols Marie-Antoinette. Les noms des religieuses de Gindou, quant aux supérieures qu’il y a eu sont : Palaudie Rose et Veyssié Anna. Je dois dire que l’instruction des filles s’est améliorée de beaucoup depuis une dizaine d’années. Toutes savent lire et un bien grand nombre lire et écrire.
L’école de Gindou ne possède pas de bibliothèque.
Dans la commune, il n’y a pas non plus de monuments, de châteaux, de tumulus, de tombeaux, de dolmen, de chapelles, ni de légendes. Voici les principaux proverbes, savoir :
Plaie d’argent n’est pas mortelle
Que ne dit mot n’en pense pas moins
Les gourmands font leurs fosses avec leurs dents
Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
A chaque oiseau nid parait beau
Il faut garder une poire pour la soif
Faute d’un point Martin perdit sont âne
Chacun à son métier, les vaches seront bien gardées.
Les chansons en usage dans le pays sont le Départ du conscrit, Jeanne d’Aymé et, de temps en temps, on entend chanter la Marseillaise.]
[Palisse Joseph."
La nature du sol de Gindou, étude menée en 1890
Liste des maires de Gindou depuis la Révolution